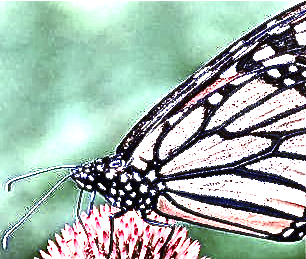La DGCCRF serait sur les dents. Le cabinet du ministre de l’Economie a en effet annoncé avoir lancé ce 3 novembre 2014 une enquête visant à savoir si pour un même produit ou service les femmes paient plus cher que les hommes. A l’origine de cette fière annonce, un des innombrables et interchangeables « collectifs » féministes qui courent le coup médiatique, les « Georgette-Sand ».
La DGCCRF serait sur les dents. Le cabinet du ministre de l’Economie a en effet annoncé avoir lancé ce 3 novembre 2014 une enquête visant à savoir si pour un même produit ou service les femmes paient plus cher que les hommes. A l’origine de cette fière annonce, un des innombrables et interchangeables « collectifs » féministes qui courent le coup médiatique, les « Georgette-Sand ».
Passé le premier rire ou le haussement d’épaules, à la vue de la une du Parisien, la confirmation, dans les heures qui ont suivi, que l’État prenait au sérieux la querelle d’une bande de copines qui font leurs courses chez Monop’ appelle quelque remarques, et questions.
Prétendre qu’il y a discrimination du fait qu’un rasoir rose coûte plus cher de quelques centimes qu’un rasoir bleu, comme si les consommateurs en situation de l’acheter étaient considérés selon leur sexe, est un curieux procès à l’endroit tant des commerçants qui diffusent ces produits que de ceux qui les fabriquent. En fait, on ne sait pas trop à qui le procès est intenté ; le bonheur de la dénonciation l’emporte sur le souci de qualifier l’imputation.
Tant pis si la femme ou l’homme qui fait les courses est susceptible d’acheter indifféremment des produits « féminins » ou « masculins », si des écarts de prix relatifs à des produits dont on ne peut présumer qui en sera l’acquéreur – même si on devine le sexe de leur utilisateur (pour autant qu’ils ont été ciblés) – ne constituent en rien une discrimination.
Pourquoi ne pas aller au bout ? C’est le marketing qui est en soi une entreprise de discrimination, et il faut blâmer aussi les fabricants de jouets de pratiquer une discrimination par l’âge.
Les Français seraient ignorants en économie ; et voilà que l’État les encourage à ignorer que, derrière les produits, les « unités de besoin » diffèrent souvent d’un sexe à l’autre. Faut-il douter de la physionomie des Georgettes au point de rappeler, à propos de ce pauvre rasoir, les parties du corps qui, dans un cas où dans l’autre, appellent son usage ?
Et l’État feint-il d’ignorer que les entreprises assurent leur bénéfice en jouant de la marge ou du volume, selon que les volumes sont plus ou moins élevés, les produits plus ou moins concurrencés, la clientèle plus ou moins fidèle à une marque, etc. Les rasoirs roses ne coûtent vraisemblablement pas beaucoup plus cher à produire que les bleus, mais s’il s’en vend moins, ils sont plus chers. Si l’on compare d’autres produits sexués comme les crèmes hydratantes, on constatera sans doute un effet symétrique (offre et clientèle plus étroites côté masculin, et positionnement décalé vers le haut de gamme…), effet qu’on se gardera d’appeler « man tax ».
Ah oui, dira Georgette, mais les coiffeurs ? Les coiffeurs et les coiffeuses sont des personnes qui travaillent. Combien de temps passe Georgette entre les mains du coiffeur ? La DGCCRF va-t-elle planquer dans les salons de coiffure pour découvrir qu’Alfred en a fini en vingt minutes et Georgette en quarante ?
Belle campagne que celle qui tend à accréditer l’idée que le temps de travail est indifférent à la valeur des services et des produits ! Mais campagne bien en phase avec les attendus d’un certain consumérisme. La valeur du travail des autres, ça ne compte pas. Seule compte la fièvre consommatrice de Georgette.
Et son pouvoir d’achat contrarié par la « woman tax »…
Qualifier de « taxe » les écarts de prix entre des produits soumis aux mêmes impositions est un abus de langage auquel les pouvoirs publics, sinon les « collectifs », devraient s’épargner de succomber. D’autant plus que la disparition revendiquée de cette prétendue taxe, sous couvert de mise à niveau des prix entre produits « genrés », prendra évidemment la forme d’une demande de baisse des produits roses plutôt que de hausse des produits bleus. Pour Georgette, ça va de soi. Pas pour celles et ceux qui fabriquent ce qu’achète Georgette. Le même jour où le Parisien titrait sur la « woman tax », les Echos mettaient en une le spectre de la déflation et le syndrome japonais qui menacent l’Europe…
Il est peu probable qu’à Bercy on ignore tout de ces circonstances. Mais y aurait-on oublié, au fait, que les prix à la consommation, jusqu’à plus ample informé, sont libres, depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986 ? Cela relèverait de l’inconséquence – à moins qu’on n’y prépare une nouvelle ordonnance sur le sujet, ou un projet de loi Georgette ?
Qu’un ministre qui fut cosignataire d’un « rapport sur les freins à la croissance » et qui ne fait pas aujourd’hui mystère de l’inquiétude que lui inspirent les tendances déflationnistes à l’œuvre sur les marchés, se laisse circonvenir par une démagogie de ce tonneau est un aveu de faiblesse préoccupant.
Il est peu vraisemblable, bien sûr, qu’il en soit dupe, mais le cas alors est plus grave. Grave que devant n’importe quelle récrimination de n’importe quel groupuscule féministe la raison rende les armes. Et qu’elle ne les rende pas sans inconvénient même pour ce ministre, puisque sa reddition affecte directement les moyens dont il a la charge et les priorités politiques qui sont les siennes.
La DGCCRF, principale administration de contrôle dans le domaine de l’économie, est-elle si dépourvue d’occupations en ce moment, ou dispose-t-elle d’effectifs soudain si généreux, pour que sa tutelle lui confie une enquête sur cette querelle de muscadines ?
Il s’agit en somme de savoir au détriment de quelles missions les ressources de cette administration vont être dévoyées : la lutte contre la tromperie sur les sites de e-commerce, la sécurité des produits, le non-respect des délais de paiement, la sous-traitance pressurée par la course aux prix bas, les prix agricoles, les clauses abusives (liste non exhaustive, voir pour complément http://www.economie.gouv.fr/dgccrf) ?
Par curiosité, bien sûr.