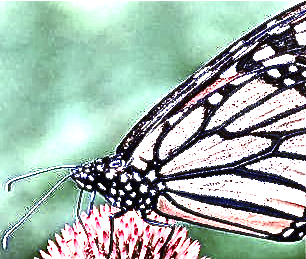Le 8 mars, date désormais revêtue de la prééminence dans le calendrier du marketing idéologique, revêt en 2016 une importance particulière pour les tenants de la doxa, après les événements de Cologne. Car ils en ont mis en jeu les fondements mythologiques.
Avec l’implication quasi exclusive de populations immigrées d’origine arabo-musulmane à dominante maghrébine, selon les rapports de police[1], les agressions qui ont marqué le réveillon allemand ont pris de court le plus visiblement les gauches morales du féminisme et de l’antiracisme, mais au-delà de ces franges les plus politisées, c’est tout le confort axiologique du féminisme qui en a été affecté, ne lui laissant d’autre option que l’amalgame.
Le 18 janvier, un « collectif » d’organisations tenait ainsi à Paris un rassemblement dénonçant « les violences faites aux femmes, le sexisme, le racisme » où la posture avantageuse du refus de toute « récupération » pour « discréditer la politique d’accueil des réfugiés » faisait figure de clause de style avant cette réformation principielle : « En aucun cas les violences faites aux femmes n’ont à être instrumentalisées ! Elles ont lieu dans tous les pays, dans tous les milieux, dans tous les espaces. »[2]
En somme, si révoltant que ce soit, il ne se serait rien passé que d’ordinaire auquel l’événement s’amalgame.
Or les témoignages sur l’atmosphère qui régnait autour de la gare de Cologne (le Monde du 21 janvier 2016) laissent assez voir que le phénomène de foule qui se jouait là était d’une autre nature que ce qui réunit ordinairement les bandes affinitaires ou vicinitaires de jeunes mâles en rut.
Et la thèse policière d’un genre d’émeute délibérément organisée fait figure de bricolage ad hoc.[3]
Ces hommes, souvent mûrs, étaient trop nombreux pour ne pas être anonymes les uns pour les autres. Leur communauté de condition (« des hommes bruns », dit une rescapée citée par le Monde) ne fait guère de doute et rien ne va mieux l’attester que les efforts et les mensonges de la police locale pour le cacher : tous arabo-musulmans, la plupart « nafris », maghrébins mais demandeurs d’asile et assimilés aux « réfugiés Merkel ». Et tous sexuellement frustrés. Prêts à s’abuser d’une apparence de carnaval.
Il ne reste pas grand-chose en Europe, du renversement périodique et grotesque des normes et des hiérarchies, qui renvoie aux saturnales romaines et à leur parfum de foutre. Quelques villes de carnaval en entretiennent le souvenir plus ou moins spectral, Cologne, donc, plus bruyamment que Nice, mais il n’est pas toujours besoin d’attendre mardi gras pour apercevoir l’ectoplasme ; l’ordre social alloue aux pulsions dionysiaques quelques brefs moments très encadrés lors de fêtes profanes, comme en France le bal du 14-Juillet, ou telle « fête » locale que ses acteurs ont assez légitimée pour ce faire, ou réveillon du 31 décembre.
S’il ne manque qu’une observation au dernier roman de Houellebecq, c’est qu’en sa répugnance grandissante à risquer symboliquement l’ordre du monde, l’Occident et son esprit de sérieux finira pas être mûr pour la conversion. Car l’islam a instauré depuis longtemps la civilisation la plus acharnée à interdire, prévenir, compenser ou réprimer le désordre carnavalesque, la suspension du jugement moral, la décompression. La pression sociale à l’inverse, toujours chez lui identifiable à la volonté unie de son Dieu lointain mais vétilleux, ne souffre pas d’intermittence, a fortiori pas de rupture. Sinon la rupture du jeûne arrosée de soda. Pauvre soupape.
La rencontre soudaine, à la défaveur d’une migration subie, avec l’égalité des sexes, la mixité du quotidien et des lieux publics, la relative permissivité qui prévaut en Europe, en même temps qu’avec la prééminence symbolique et morale qu’y occupent les femmes, n’a pas laissé à ces hommes le temps d’un commencement d’acculturation. Tout les égare. A Cologne, la réinterprétation empirique, dans leur imaginaire inégalitaire sous le critère du sexe, de l’apparence de désordre des mœurs va les conduire au même moment dans un même lieu, avec les mêmes dispositions. Il ne leur aura fallu qu’un signal.
Ce signal, c’est le 31 décembre et ses promesses, le seul événement festif à caractère un tant soit peu transgressif qui se soit universalisé, et jusqu’en terre d’islam, où à défaut d’occasionner de grands chahuts il rend plus tangible à ses ressortissants (au spectacle télévisé du vacarme qu’il fait ailleurs) ce que cette culture porte d’ennui et de résignation.
Le 31, fête mondialisée, fête aussi de la mondialisation. Or de cette société mondiale de la marchandise, dont le 31 célèbre la joie avec ce qu’il faut de rots et d’obscénités, les « réfugiés » à majorité musulmane sont les ilotes, et les Allemands les maîtres (parmi d’autres s’entend).
Les esclaves aujourd’hui, ce sont ceux que la guerre ou la misère déracinent et dont le sort dépend du bon vouloir des Etats hôtes. Une sourde rumeur s’est répandue parmi eux que dans cette ville, et ce jour, leur frustration serait fugitivement allégée. Qu’ont fait les « hommes bruns » du 31 décembre ? Ils ont renversé la hiérarchie habituelle entre les hommes de la façon la plus transgressive, la plus carnavalesque : en s’en prenant aux femmes de leurs maîtres.
Pourtant l’interdit pèse, il s’énonce dans un langage dont ils ignorent le code, mais il n’est pas absent. Les « hommes bruns » savent que ces femmes ne sont pas les leurs et que la loi les protège. Une loi, du moins. Mais une norme qu’ils ont assez intériorisée et qu’ils partagent assez entre eux pour que demeure bridée la dynamique d’une violence de foule, de ce qui aurait été une émeute sexuelle. La transgression ne sera pas collectivement assumée. Si nombreuses qu’elles seront, les agressions sexuelles, au regard de la foule que la même pulsion travaille, seront sporadiques.
La presse de droite[4] montera en épingle les propos lénifiants de la mairesse de Cologne sur la « distance d’un bras », pour conclure que le féminisme cède le pas au tiers-mondisme … Mauvaise pioche. Si l’opinion féministe rechigne à nommer les agresseurs pour ce qu’ils sont, ce n’est pas tant par scrupule « antiraciste » que par crainte de perdre sa principale raison d’être : la fable d’un « patriarcat » persistant dans le monde occidental.
Le « pas-d’amalgame » (des migrants aux agresseurs) n’est qu’alibi. Au-delà de la commisération pour les victimes des agressions, ce que le féminisme déplore est que l’événement ne se soit pas plié à la raison idéologique, et même qu’il la démente : les agresseurs, au moins une partie significative d’entre eux, auraient dû être allemands[5].
D’où l’importance pour les groupes féministes ultras, d’abord enclins à la prudence, de réaffirmer la force de slogans affirmant la consubstantialité du féminisme et de l’antiracisme[6]. Gentiment encouragés depuis les palais nationaux à faire un peu de bruit pour conjurer le risque de « dérive xénophobe », OLF et autres sectes auraient de toute façon dû se résoudre à sortir du bois, pour réaffirmer la faute primordiale du mâle occidental. Heureusement que le 8 Mars y pourvoit d’abondance.
[1] http://www.lefigaro.fr/international/2016/01/12/01003-20160112ARTFIG00267-cologne-la-police-designe-des-delinquants-maghrebins.php.
[2] Les termes typiques employés par ledit collectif, repris par exemple sur https://effrontees.wordpress.com/2016/01/16/cologne-contre-les-violences-faites-aux-femmes-contre-le-sexisme-contre-le-racisme.
[3] Si la pensée magique s’est déployée surtout à gauche dans l’affaire de Cologne, les tentatives de manipulation de l’opinion ne s’y sont pas limitées. Il a aussi fallu à ceux que la passion féministe laisse plus froids trouver une cause agissante, et rassurante, à des événements d’une radicalité profonde (si l’on veut bien excuser le pléonasme). Les services de police ont ainsi inventé des « réseaux criminels marocains » qui auraient prémédité et organisé un harcèlement de masse à la manière du « taharrush gamea » des foules de la place Tahrir au Caire. Ou la pègre saisie par le goût de la publicité…
[4] Valeurs actuelles, prompt à en faire son miel.
[5] Or tout au plus la police annoncera-t-elle à la mi-janvier, dans un décompte hautement sujet à caution, que parmi une trentaine de suspects arrêtés figurent « un Serbe, un Américain et trois Allemands » (www.huffpostmaghreb.com/2016/01/13/cologne-marocains-algeriens_n_8968738.html).
[6] Cf. par exemple la pathétique visée théoricienne de Jules Falquet, « La “Nuit du 31 décembre 2015” en Allemagne et ses effets en France : Diviser les opprimé-e-s, tant qu’illes [sic] se laissent faire » in Mouvements, 5 mars 2016 (http://mouvements.info/la-nuit-du-31-decembre-2015-en-allemagne-et-ses-effets-en-france-diviser-les-opprime-e-s-tant-quilles-se-laissent-faire/) : «Au même moment, d’autres hommes, en Allemagne et ailleurs, ont pu, comme chaque année et comme chaque jour, exercer toutes sortes de violences sexuelles routinières, dans les établissements scolaires, les lieux de travail, les maisons ou les rues. (…) Les hommes blancs ont raison d’avoir des craintes. Si les femmes blanches et les hommes racisés s’unissaient et, plus largement même, si l’ensemble des femmes et l’ensemble des racisé-e-s s’unissaient, leur règne serait bien compromis. »