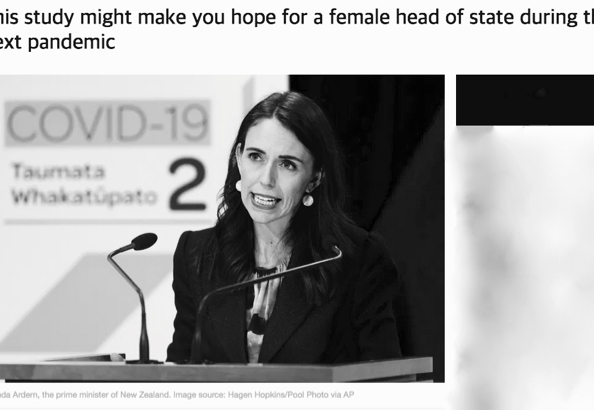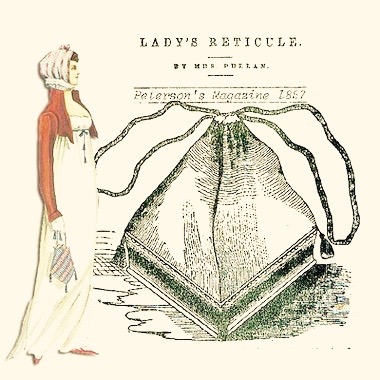Quand il s’agit du catéchisme des inégalités-de-genre-au-travail, la presse économique de référence a des références trop pressées.
Dans leur édition du 14 juin 2017, les Échos publient un discret mais éloquent téléscopage des implicites féministes qui formatent les esprits.
Page 4, un article consacré à l’embauche des jeunes diplômés des grandes écoles se conclut, après l’intertitre alarmiste « Inégalité hommes-femmes », par le constat hâtif que dans la « promotion 2016 des diplômés l’écart de salaire entre un homme et une femme diplômés de la même école de management est de 2 000 euros ». Ce qui ne fait qu’enregistrer un effet structurel des différences de fonctions auxquelles les jeunes managers de l’un et l’autre sexe ont choisi de postuler – plus commerciales et financières pour les hommes, plus juridiques et marketing pour les femmes –, alors que les perspectives de gain y sont diverses (pour des raisons propres au génie du capital et on ne peut plus indifférentes à l’entrejambe), est proposé par la rédactrice à l’indignation du lecteur en suggérant qu’il y a là « inégalité » de traitement à travail égal. Quand il n’est pas égal.
Sur le sujet, les journaux sont pleins de ces raccourcis, mais il était particulièrement plaisant, ce 14 juin, de trouver en vis-à-vis page 5 dans le même quotidien le chapô d’un papier « santé » sur le risque cancérigène auquel les salariés sont exposés : « Les hommes et les ouvriers sont les plus concernés. » Le texte qui suit le précise : 75 % des salariés exposés sont des hommes. Mais là, le rédacteur ne tombe pas dans le piège du raccourci ; il n’est pas question d’« inégalité » au détriment des hommes. Qui pourrait concevoir pareille idée ?
Pourtant, toute pondération considérée (proportion d’actifs par sexe, etc.), le fait que les hommes occupent plus que les femmes les professions les plus dangereuses résulte bien plus, s’agissant d’ouvriers, de contraintes qui les dépassent que d’un choix de carrière. Surtout si l’on compare les parts respectives pour eux de l’appétence et de la contrainte avec les positions sur le marché du travail de jeunes manageuses fraîchement émoulues d’une ESC.
Suggérons aux deux journalistes des Échos une enquête à quatre mains sur ce thème : comment se fait-il que les hommes occupent plus que les femmes à la fois les professions les plus lucratives et les plus dangereuses (pour la santé ou l’intégrité physique) – qui sont parfois mais rarement les mêmes –, et occupent aussi les plus lucratives parce que les plus associées à une prise de risque (hors risque sanitaire) ?